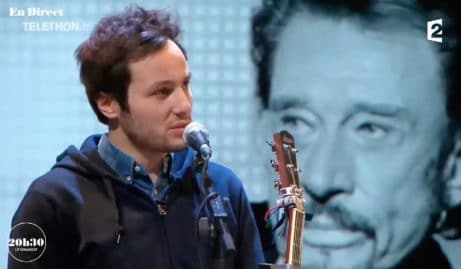Attention, depuis le 1er juillet, des voitures radars privées circulent dans ces départements
Depuis plusieurs mois, les voitures radars privées se multiplient sur les routes françaises afin de renforcer la lutte contre les excès de vitesse. Le principe est simple : des véhicules banalisés, confiés à des prestataires privés, circulent selon un itinéraire défini par l’État et détectent automatiquement les conducteurs en infraction.

Ce recours à des sociétés extérieures marque une évolution notable dans la politique de contrôle routier. L’objectif est d’accroître la présence de moyens mobiles sans surcharger les forces de l’ordre traditionnelles, tout en restant discret pour maximiser la surprise et la conformité des automobilistes.
Le résultat se mesure en chiffre : plus de soixante zones de surveillance sont désormais couvertes, avec un objectif de 300 voitures opérationnelles d’ici la fin 2025. Cette montée en puissance s’inscrit dans un plan national qui ambitionne de réduire sensiblement le nombre de tués et de blessés sur les routes.
Une stratégie nationale renforcée
L’essor des voitures radars privées fait suite à une vaste concertation entre la Sécurité routière et les services de l’État. Face à la hausse des vitesses excessives constatée sur certains axes, les autorités ont décidé d’innover pour rendre le contrôle à la fois plus systématique et moins visible.
En confiant ce volet à des entreprises privées, l’État tire parti de leur flexibilité logistique, tout en garantissant la traçabilité des infractions grâce à des systèmes embarqués certifiés. Chaque véhicule respecte un cahier des charges strict, assurant la fiabilité et la conformité des appareils de mesure.
Cette stratégie s’étend sur le territoire national, avec une attention particulière portée aux régions les plus accidentogènes. Les zones périurbaines, souvent délaissées par les radars fixes, deviennent ainsi des cibles privilégiées pour ces contrôles itinérants.
Fonctionnement des véhicules banalisés
Les véhicules banalisés utilisés sont sélectionnés parmi des flottes de location, généralement des modèles courants peu repérables. Ils sont équipés de capteurs laser ou doppler reliés à une unité de prise de vue, intégrée directement dans le toit ou le pare-brise.
Les chauffeurs, salariés des prestataires, suivent un itinéraire préétabli et roulent scrupuleusement à la vitesse autorisée. Leur mission est uniquement de conduire : l’enregistrement des infractions et leur transmission à l’administration relève d’un traitement automatisé, garantissant une neutralité totale.
Chaque infraction détectée fait l’objet d’un flash photographique et d’un enregistrement horodaté, mentionnant position GPS et vitesse mesurée. Les données sont ensuite transmises à la plateforme nationale qui établit l’avis de contravention et le fait parvenir au titulaire du certificat d’immatriculation.
Enfin, une fois leur tournée terminée, les véhicules retournent au dépôt du prestataire où les relevés sont centralisés et contrôlés avant toute notification formelle aux conducteurs sanctionnés.

Témoignages et retours d’expérience
Plusieurs élus locaux et associations de victimes se sont prononcés en faveur de ce dispositif. Selon eux, la sécurité routière bénéficie d’une couverture plus uniforme, tandis que la prévention est renforcée par l’effet de surprise.
Dans certaines communes, les habitants soulignent une baisse sensible de la vitesse moyenne sur les axes traversants. Les usagers réguliers notent également une amélioration du comportement global, incités à lever le pied même hors des contrôles fixes traditionnels.
À lire aussi
Pour autant, des voix s’élèvent pour réclamer davantage de transparence sur les critères de choix des itinéraires et sur le calibrage des appareils. Les prestataires assurent que tous les radars utilisés sont certifiés selon les mêmes normes que les radars automatiques de l’État.

Formation des chauffeurs et fiabilité du système
Les conducteurs recrutés pour piloter ces véhicules bénéficient d’une formation spécifique aux règles de la route et aux équipements embarqués. Ils doivent respecter une charte déontologique qui interdit toute action supplémentaire, telle que poursuite ou interception d’un véhicule.
Un audit régulier des équipements est réalisé pour vérifier la conformité des dispositifs de mesure et le bon entretien des véhicules. Les prestataires sont soumis à des contrôles inopinés par les services de l’État pour garantir le respect des obligations contractuelles.
Cette rigueur institutionnelle vise à éviter tout litige ultérieur et à garantir que seuls les conducteurs réellement en infraction soient sanctionnés. Conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les marges techniques expliquées
Pour tenir compte des imprécisions inhérentes aux mesures de vitesse, une marge technique est appliquée. Sur les routes limitées à 100 km/h ou moins, cette marge s’élève à 5 km/h. Au-delà, elle est fixée à 5 % de la vitesse relevée.
Concrètement, un véhicule mesuré à 91 km/h dans une zone à 80 km/h verra sa vitesse retenue abaissée à 86 km/h. Soit un excès de 6 km/h. Cette approche évite la verbalisation pour de très faibles dépassements, tout en garantissant l’efficacité du contrôle.
L’amende forfaitaire pour cet excès sera de 68 € et se traduira par le retrait d’un point sur le permis de conduire. Les sanctions augmentent de degré en fonction de l’ampleur de l’infraction. Conformément au barème prévu par le Code de la route.

Les chiffres de la montée en puissance
Déployées pour la première fois à titre expérimental, les voitures radars privées ont déjà convaincu par leur efficacité. Plus de 60 zones de contrôle sont aujourd’hui couvertes, contre seulement quelques-unes il y a un an.
D’ici fin 2025, l’objectif fixé par la Sécurité routière est d’atteindre 300 véhicules en circulation. Ce rythme de déploiement correspond à un peu plus de 20 nouveaux engins par mois. Répartis au gré des priorités régionales.
Les prestataires recrutés sont sélectionnés sur des critères de qualité de service. De disponibilité et de capacité à couvrir de longs itinéraires sans interruption, afin de maximiser le temps de contrôle effectif.
À lire aussi
Une présence géographique étendue
Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur restent pour l’instant les plus dotées en véhicules banalisés. L’initiative se concentre sur les axes secondaires souvent moins surveillés par les radars fixes.
À l’inverse, l’Île-de-France et la Corse ne font pas encore partie du périmètre de ce programme. Les autorités évaluent actuellement les besoins spécifiques de ces territoires avant de décider d’une éventuelle extension.
En zone rurale comme en périurbain, l’effet psychologique de la présence de ces véhicules se révèle souvent plus dissuasif qu’un radar fixe identifiable. D’autant que les automobilistes ne savent jamais précisément où chercher.
Impacts pour les usagers de la route
Pour le conducteur, l’apparition des radars mobiles gérés par des prestataires privés ne change pas les règles du jeu. Les limitations de vitesse restent les mêmes, tout comme les sanctions encourues en cas de non-respect.
Certains automobilistes se déclarent cependant plus attentifs, craignant un contrôle non annoncé. Cette vigilance accrue contribue à l’objectif général : réduire le nombre d’accidents et de morts sur la route.
Des voix critiquent toutefois la privatisation partielle de la sanction routière, y voyant un risque de dérive financière. Les pouvoirs publics rappellent que la mission de contrôle reste assurée par l’État. Et que les prestataires ne font qu’opérer des moyens techniques.

Perspectives d’avenir
Alors que le dispositif continue son déploiement, des réflexions sont menées pour intégrer de nouvelles technologies. Comme la vidéo-analyse ou l’intelligence artificielle. Afin d’améliorer encore la fiabilité et la rapidité des contrôles.
Parallèlement, la Sécurité routière envisage de coupler ces radars mobiles à des campagnes de sensibilisation auprès des usagers. Afin de motiver un changement de comportement durable sur l’ensemble du réseau routier.
L’objectif final est de conjuguer contrôle systématique et prévention. Pour faire de la route un espace plus sûr, sans multiplications excessives de sanctions punitives.

Votre département concerné ?
Depuis le 1er juillet, les voitures radars privées contrôlent désormais cinq nouveaux départements : l’Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, la Haute-Loire, les Pyrénées-Orientales et le Tarn-et-Garonne. Si vous circulez dans l’un de ces territoires, soyez vigilant et respectez scrupuleusement les limitations de vitesse pour éviter toute amende.