Une étude révèle un lien inquiétant entre les chats et la schizophrénie
Faut-il s’inquiéter quand on vit avec un chat ? Une nouvelle analyse signée par des chercheurs australiens a relancé un vieux débat : notre proximité avec les félins pourrait-elle influencer certains troubles psychiatriques ? Le sujet est sensible, parce qu’il touche à la fois à notre attachement aux animaux de compagnie et à des questions complexes de santé mentale. Et parce que la science n’avance jamais sans nuances.

En s’appuyant sur plusieurs décennies de travaux réalisés dans différents pays, cette publication remet les chats au centre d’une hypothèse récurrente : il existerait un lien entre leur présence au foyer et un risque accru de troubles schizophréniques. Ce n’est pas la première fois que l’idée circule, mais l’étude la plus récente lui donne une nouvelle visibilité. Elle ne tranche pas tout, elle ne condamne pas nos compagnons à quatre pattes. Elle invite surtout à comprendre ce qui se joue derrière ce possible lien.
Un parasite au cœur des soupçons
Derrière cette histoire, un nom revient sans cesse : Toxoplasma gondii. Ce parasite microscopique est bien connu des médecins et des vétérinaires. Il circule dans l’environnement, se transmet par la viande insuffisamment cuite, par de l’eau contaminée, ou via un contact avec des chats porteurs. Chez la plupart des personnes, l’infection passe inaperçue. Pourtant, ce micro-organisme a une particularité qui intrigue la recherche : une fois dans l’organisme, il peut atteindre le système nerveux central et interagir avec certains neurotransmetteurs.
Ces propriétés biologiques nourrissent une hypothèse crédible : chez une minorité d’individus, et dans des contextes encore mal définis, une exposition à T. gondii pourrait s’ajouter à d’autres facteurs et participer au déclenchement de troubles. Ce n’est pas une preuve. C’est un faisceau d’indices qui pousse les équipes scientifiques à explorer le terrain, sans effet d’annonce et sans panique. Rappel utile : des dizaines de millions d’Américains seraient porteurs du parasite sans le moindre symptôme, ce qui montre à quel point la majorité des contaminations restent silencieuses.
Ce que dit vraiment l’analyse australienne
L’équipe emmenée par le Dr John McGrath, au Queensland Centre for Mental Health Research, a repris la question à la base. Les chercheurs ont passé en revue 17 études menées sur 44 ans et couvrant 11 pays. Leur travail, publié en décembre 2023 dans le Schizophrenia Bulletin, s’inscrit dans la continuité d’une idée avancée dès 1995 : et si la possession d’un chat pendant l’enfance ou l’adolescence était associée à un risque plus élevé de troubles schizophréniques ?
Cette approche dite de synthèse s’intéresse à la cohérence d’ensemble. Elle ne se substitue pas aux études individuelles, elle les met en perspective. En agrégant ce que la littérature scientifique a produit depuis près d’un demi-siècle, les auteurs cherchent des signaux qui se répètent. Ils regardent les méthodes employées, les biais potentiels, les limites reconnues par chaque équipe, et ils tentent de dégager une tendance commune.

Corrélation ne veut pas dire causalité
Point clé souligné par les auteurs : corrélation ne signifie pas causalité. Autrement dit, même si la présence d’un chat et la survenue de troubles schizophréniques se retrouvent parfois associées dans les données, cela ne prouve pas que l’un cause l’autre. La qualité des études incluses est variable, avec des protocoles parfois inégaux et des résultats pas toujours alignés. Certaines recherches pointent un signal, d’autres ne retrouvent rien de significatif.
À lire aussi
Autre fragilité identifiée : la période critique d’exposition. Plusieurs travaux soupçonnent une fenêtre de sensibilité durant l’enfance, possiblement entre 9 et 12 ans, mais rien n’est gravé dans le marbre. La trajectoire d’un trouble schizophrénique est multifactorielle. Elle croise la génétique, le contexte social, des événements de vie, des expositions environnementales. Isoler le rôle précis d’un parasite ou d’un animal au foyer n’est pas simple, et cela demande des protocoles rigoureux, sur des échantillons représentatifs, suivis dans le temps.
Quand d’autres facteurs s’invitent dans l’équation
La piste Toxoplasma gondii n’est pas la seule discutée. D’autres pathogènes présents chez le chat ont été envisagés. La bactérie Pasteurella multocida, par exemple, est régulièrement évoquée. Elle vit dans la salive des félins et entre en jeu lors de griffures ou de morsures. Là encore, il ne s’agit pas d’affirmer que cette bactérie provoque des troubles mentaux, mais d’explorer si, dans certaines circonstances, elle pourrait influencer certains mécanismes biologiques.
C’est dans ce cadre qu’une étude américaine menée auprès de 354 étudiants en psychologie apporte une nuance intéressante : elle n’a pas trouvé de lien direct entre la simple possession d’un chat et les scores de schizotypie. En revanche, les personnes ayant déclaré avoir été mordues par un chat présentaient des résultats plus élevés sur certaines échelles psychologiques. Ce signal ne renverse pas le dossier, il rappelle simplement que la relation entre félins et santé mentale pourrait passer par des voies multiples, y compris des expositions très concrètes.

Pourquoi le débat revient si souvent
Si ce sujet capte autant l’attention, c’est qu’il touche à quelque chose de très quotidien : la place de l’animal dans nos vies. Le chat est l’un des compagnons les plus présents dans les foyers. On le perçoit comme indépendant, parfois mystérieux, mais les études montrent qu’il tisse un lien fort avec ses humains. Lorsqu’une publication scientifique suggère que cette proximité pourrait s’accompagner d’un risque, même faible, le débat s’enflamme.
Il faut garder le cap : ce que dit la littérature, c’est qu’il existe des indices d’association, pas un verdict. Les chercheurs appellent à des travaux de haute qualité pour clarifier les mécanismes potentiels. Ils insistent aussi sur l’exploration d’autres facteurs environnementaux qui pourraient interagir avec le parasite ou avec le comportement du chat. La prudence n’exclut pas la curiosité scientifique. Elle l’encadre.

Ce que cette étude ne dit pas
L’analyse australienne ne dit pas d’abandonner son chat. Elle ne dit pas que tous les foyers seront touchés. Elle ne propose pas non plus un dépistage de masse ou des recommandations radicales. Et met en lumière une relation complexe qui mérite d’être mieux comprise. À ce stade, la priorité est d’améliorer les protocoles, d’éviter les biais, de préciser les périodes d’exposition, et d’étudier les populations sur la durée.
À lire aussi
Cette démarche est d’autant plus importante que des millions de personnes vivent avec des félins sans jamais développer de troubles schizophréniques. Autrement dit, si un risque existe, il est probablement modulé par une combinaison de paramètres individuels et contextuels. La bonne question n’est pas de savoir s’il faut ou non avoir un chat, mais de comprendre comment des expositions biologiques ou comportementales peuvent, chez certains, peser dans la balance.

Le rôle de Toxoplasma : plausible, mais à préciser
Revenons à Toxoplasma gondii. Son cycle de vie, sa capacité à entrer dans le cerveau. Son interaction avec les neurotransmetteurs en font un candidat sérieux. Pour expliquer une partie des associations observées. Les voies de transmission sont connues : viande peu cuite, eau contaminée, contact avec des chats porteurs. La plupart du temps, l’infection est silencieuse. Mais chez une minorité, elle pourrait, en combinaison avec d’autres facteurs. Contribuer à des altérations subtiles qui, accumulées, finissent par compter.
À ce stade, aucun raccourci ne tient. On ne passe pas de « toxoplasmose » à « schizophrénie » par une simple flèche. Les auteurs de l’étude invitent à multiplier les approches, à s’appuyer sur de larges échantillons représentatifs, à mieux cadrer les périodes d’exposition. Et à intégrer d’autres pistes comme Pasteurella multocida ou des facteurs environnementaux encore sous-étudiés.

Ce qu’il faut garder en tête
La question de la possession d’un chat et de la schizophrénie n’est pas tranchée. Elle progresse au rythme des données. L’étude australienne, publiée dans le Schizophrenia Bulletin par l’équipe du Dr John McGrath, a le mérite de remettre de l’ordre dans une littérature foisonnante. Elle rappelle que des signaux existent. Que tous ne convergent pas, et qu’il faut des recherches plus fines pour séparer le bruit de l’information.
Et la révélation que beaucoup attendaient tombe à la toute fin de leur analyse. En agrégeant les travaux réalisés depuis 1995, les auteurs estiment que les personnes exposées aux chats présentent. En moyenne, un risque environ doublé de troubles schizophréniques par rapport à celles qui ne le sont pas. Cette estimation ne vaut pas preuve définitive. Elle fixe un ordre de grandeur à tester, affiner et, peut-être, à confirmer.
- 03/09/2025 à 00:28A la lecture de cet article, je m interroge grandement sur la possibilité qu effectivement ce soit vrai. Que faire alors?Ce toxoma gondii peut on s en débarrasser ou une fois infectée il faut gérer la maladie mentale?



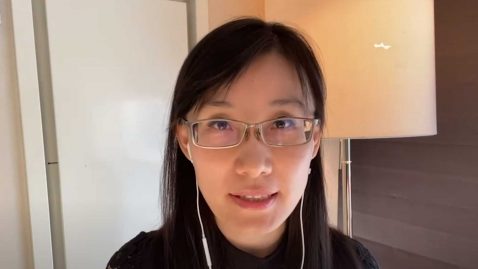


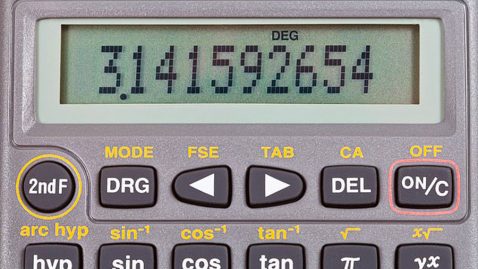
1 commentaire