Budget : remboursement intégral des malades chroniques – Bayrou veut en supprimer une partie, voici ce que cela implique
Au cœur des débats budgétaires de l’été 2025, la question des dépenses de santé pèse lourd sur l’équilibre des comptes publics. Chaque année, la France consacre une part importante de son budget aux remboursements effectués par l’Assurance maladie pour les soins et les traitements des patients. Dans ce cadre, les affections de longue durée, dites ALD, représentent une part significative des dépenses sociales.

En 2022, selon l’Assurance maladie, 13,8 millions de Français bénéficiaient du dispositif ALD en raison d’une pathologie chronique exigeant un suivi et des traitements souvent onéreux. Ce chiffre équivaut à plus de 20 % de la population nationale. Un poids considérable pour le système de protection sociale.
Les ALD exonérantes permettent aux patients concernés de se faire rembourser leurs soins « à 100 % » lorsqu’ils sont directement liés à leur maladie. Ce taux intégral couvre la quasi‐totalité des frais hospitaliers, de consultations, d’examens et de médicaments. Hors dépassements d’honoraires. Dans la limite des tarifs fixés par l’Assurance maladie.
Pour atteindre un objectif global de réduction de 5 milliards d’euros des dépenses sociales annuelles. Le Premier ministre François Bayrou a annoncé vouloir resserrer les conditions de prise en charge des ALD. L’idée est de maîtriser une partie des coûts jugés jugulables sans remettre en cause le cœur du dispositif.
L’enjeu est double : préserver la pérennité de la protection sociale et garantir une solidarité financière envers les plus fragiles. Les modalités exactes de ce resserrement restent à préciser. Mais il s’agit pour l’exécutif de reprendre la main sur certains postes de dépenses.
Dans les faits, une clarification des règles de remboursement apparaît nécessaire pour éviter les dérives et les usages abusifs du système. Tout en maintenant un accès optimal aux soins des patients chroniques.

Définition et critères de l’ALD exonérante
Une ALD exonérante s’adresse aux personnes atteintes d’une maladie grave, évoluant sur plus de six mois et nécessitant un traitement coûteux. Pour en bénéficier, le patient doit être diagnostiqué avec une des plus de quarante pathologies listées par l’Assurance maladie. Et validées par un protocole national de soins.
Parmi les affections les plus courantes figurent le diabète, le cancer, le trouble bipolaire, la maladie de Crohn. Et l’AVC invalidant. Chacune de ces maladies implique un suivi médical régulier et des traitements parfois très onéreux. Justifiant la prise en charge intégrale.
Le remboursement « à 100 % » couvre les actes et médicaments directement liés à la pathologie chronique. Les consultations en cabinet, les séjours hospitaliers. Les examens de laboratoire et les traitements pharmacologiques concernés ne génèrent aucun reste à charge pour le patient. Hors dépassement d’honoraires.

Toutefois, si le prestataire de soins pratique des tarifs supérieurs au tarif de base de l’Assurance maladie. Le patient devra s’acquitter de la différence. La logique est de garantir un remboursement intégral dans la limite des montants réglementaires. Sans pour autant abolir la libre tarification selon les professionnels.
La loi prévoit également une dispense d’avance de frais pour les patients ALD. En pratique, cela signifie que l’Assurance maladie règle directement le professionnel, évitant au malade de mobiliser de la trésorerie pour ses soins.
Cette exonération vise à alléger le parcours de soins pour les patients chroniques. En supprimant l’obstacle financier au moment de la prise en charge. Tout en encadrant strictement les modalités de prise en charge par l’Assurance maladie.
Processus d’activation du statut ALD
À lire aussi
Pour qu’un patient soit reconnu ALD, son médecin traitant doit établir une demande auprès de l’Assurance maladie. En fournissant un certificat médical détaillé décrivant la gravité, la durée et le coût du traitement. Cette démarche administrative enclenche l’enregistrement du patient dans le dossier de la Sécurité sociale.
Une fois la reconnaissance prononcée, le patient reçoit un avis officiel l’identifiant comme bénéficiaire du statut ALD exonérante. Dès lors, c’est l’Assurance maladie qui prendra en charge directement les frais liés à la pathologie. Sans que l’assuré n’ait à avancer de frais.
Lors des consultations en cabinet ou à l’hôpital, le professionnel de santé applique le tarif de base. Qui sera remboursé intégralement. La part complémentaire, normalement prise en charge par une mutuelle. Est elle aussi couverte par l’exonération ALD dans la limite des tarifs réglementés.
À la pharmacie, le patient présente simplement son ordonnance et sa carte Vitale. Le pharmacien est informé du statut ALD. Et procède au tiers payant intégral pour les traitements liés à la maladie chronique. Garantissant l’absence d’avance de frais.
Ce processus, bien que fluide en apparence, nécessite une coordination étroite entre praticien, Assurance maladie et pharmacien. Toute erreur dans la déclaration ou dans la prise en charge peut entraîner un rejet de remboursement. Et laisser le patient exposé à des coûts imprévus.
La simplification du parcours administratif est au cœur des préoccupations de l’Assurance maladie. Qui cherche à automatiser certaines démarches pour alléger la charge des médecins et des assurés.

L’ordonnance bizone en pratique
L’ordonnance bizone constitue l’outil principal pour distinguer les traitements ALD de ceux pris en charge de façon classique. La partie haute de l’ordonnance recense les actes et les médicaments en lien direct avec la pathologie chronique. Remboursés à 100 %. La partie basse regroupe les soins sans rapport avec l’ALD. Remboursés selon le taux standard (70 % ou 65 % selon les cas).
Cette distinction est essentielle pour maintenir la rigueur du système. En pratique, le médecin coche la zone réservée à l’ALD pour chaque ligne de prescription relevant de la maladie chronique. Les autres prescriptions, qu’il s’agisse d’un traitement antibactérien pour une infection passagère ou d’un anti-inflammatoire léger, sont inscrites en zone 2.
Cette double classification permet à l’Assurance maladie de contrôler les flux financiers et de limiter les dépenses liées aux maladies longues. Elle impose toutefois une attention constante de la part des praticiens, qui doivent décider au cas par cas de l’inclusion d’un médicament en zone haute ou basse.
L’ordonnance bizone représente un équilibre entre souplesse pour le médecin et rigueur pour l’assureur. Elle facilite la prise en charge intégrale du cœur de la pathologie tout en préservant la maîtrise budgétaire sur les soins annexes.
Sa mise en place remonte aux premières années du dispositif ALD, lorsque le législateur a souhaité séparer les traitements essentiels de ceux jugés « hors sujet », afin d’éviter la dérive des remboursements.
Zones grises et risques d’usages abusifs
Dans la pratique, la frontière entre traitements liés et non liés à l’ALD n’est pas toujours évidente. De nombreux médecins, par souci de simplicité, inscrivent l’ensemble des prescriptions en zone haute, ce qui peut générer des remboursements intégralement pris en charge alors que certains médicaments ne concernent pas la pathologie chronique.
Pierre-Olivier Variot, président de l’Union de syndicats de pharmaciens d’officine, observe que « beaucoup de médecins mettent par facilité tous les traitements dans la case 100 %, qu’il s’agisse d’hypnotiques ou de médicaments contre la constipation ». Cette pratique, si elle profite au patient, pèse sur le budget de l’Assurance maladie.
À lire aussi
À l’inverse, certains spécialistes omettent parfois de cocher la zone ALD pour des médicaments très coûteux mais pourtant liés à la maladie, laissant le patient supporter une partie des frais. Ces erreurs d’écriture peuvent résulter d’un simple oubli ou d’une méconnaissance des recommandations officielles.
Le docteur Jean-Christophe Nogrette de MG France illustre ces zones d’ombre : « Pour une polyarthrite rhumatoïde traitée par anti-inflammatoires à forte dose, on prescrit souvent un antiulcéreux pour prévenir un ulcère gastrique secondaire. Doit-on le rattacher à la polyarthrite ou non ? » Chaque praticien tranche selon son appréciation, créant parfois des discordances.
Cette marge d’interprétation fait l’objet de contrôles réguliers de la part de l’Assurance maladie. Les pharmaciens peuvent être amenés à contester un remboursement ou à solliciter une précision du médecin titulaire de l’ordonnance pour vérifier le rattachement véritable de certains traitements.
Pour limiter ces abus potentiels, des guides de bonnes pratiques et des formations sont régulièrement dispensés aux professionnels de santé, afin d’harmoniser l’usage de l’ordonnance bizone et d’améliorer la traçabilité des prescriptions ALD.

Enjeux financiers et perspectives
Dans son plan de réduction de 5 milliards d’euros des dépenses sociales, le gouvernement a ciblé plusieurs leviers d’économies, dont la maîtrise des remboursements ALD. Pour cela, il souhaite resserrer les conditions de prise en charge et renforcer les contrôles.
François Bayrou a évoqué la nécessité de mettre fin à certains remboursements à 100 % jugés injustifiés, afin de préserver l’équilibre des comptes sociaux sans toucher au cœur du dispositif ALD. Les modalités précises de ce resserrement restent à définir, notamment sur la question des traitements « hors lien ».
Les syndicats de pharmaciens et de médecins expriment des réserves quant à une réforme trop brutale, craignant qu’elle n’alourdisse la charge administrative et ne pénalise les patients les plus fragiles. Ils plaident plutôt pour une meilleure formation et une clarification des règles de prescription.
Du côté des associations de malades, la vigilance est de mise : toute restriction trop stricte pourrait créer des ruptures de soins pour des patients déjà vulnérables, parfois contraints de choisir entre la santé et le reste à charge.

Parmi les pistes évoquées figurent l’automatisation accrue du contrôle des prescriptions, l’actualisation régulière des listes de pathologies éligibles et la mise en place d’outils de traçabilité pour réduire les divergences d’interprétation entre praticiens.
Vers une réforme ciblée du dispositif ALD pour préserver l’équilibre du système de santé
Ce débat soulève une question centrale : comment concilier solidarité et rigueur budgétaire lorsqu’il s’agit de garantir un accès équitable aux soins des personnes en situation de maladie chronique ?
C’est en gardant ce cap que le gouvernement entend, à terme, proposer un dispositif plus transparent, stable et durable, tout en préservant la qualité de vie et la prise en charge intégrale des patients concernés.
À la toute fin du débat, François Bayrou a donc annoncé la mesure phare de son plan : mettre un terme au remboursement à 100 % des médicaments « sans lien » avec l’affection de longue durée, en instaurant une « sortie du statut ALD » lorsqu’un suivi strict ne serait plus justifié.


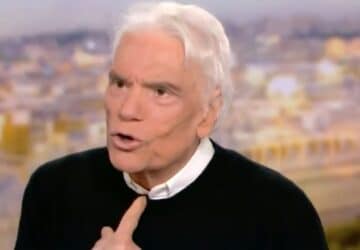




4 commentaires