Durcissement du baccalauréat : s’il était évalué comme il y a 40 ans, on aurait un taux de réussite de 60%
Ce vendredi 5 décembre, le ministre de l’Éducation Édouard Geffray a annoncé sa volonté de resserrer les règles de correction du baccalauréat. Entre copies truffées de fautes, fin annoncée des « coups de pouce » et inquiétude sur la valeur du diplôme, le débat a aussitôt enflammé le monde éducatif. Un enseignant et essayiste, spécialiste de l’école, y voit même un sérieux contre-sens.

Car derrière cette réforme technique se cache une question beaucoup plus sensible : que vaut vraiment le bac aujourd’hui, et que se passerait-il si l’on jugeait les copies avec la sévérité d’autrefois ? La réponse, loin d’être anecdotique, interroge tout le fonctionnement du lycée et la place de l’examen dans la société française.

Crédit : Alison wood / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Un bac plus strict annoncé par le ministre
En annonçant un durcissement du baccalauréat, Édouard Geffray a ciblé en priorité la manière dont les copies sont corrigées. L’une de ses mesures phares consiste à mettre fin aux fameux « coups de pouce » accordés en fin de correction. Ces points supplémentaires permettaient à un élève frôlant la moyenne de décrocher in extremis le droit au rattrapage, et parfois de sauver son année.
Le ministre souhaite également que les copies « truffées de fautes » ne puissent plus obtenir automatiquement la moyenne. Derrière cette décision, il y a l’idée que l’orthographe et la maîtrise de la langue doivent redevenir des critères visibles dans la note. Pour certains, c’est une façon de redonner du sérieux à l’examen. Pour d’autres, c’est surtout une réponse politique à l’angoisse récurrente autour du taux de réussite du bac.
Ce changement intervient dans un contexte où le bac affiche des résultats très élevés. Lors de la session de juin 2025, le taux de réussite global atteignait 91,8 %, et même 94,4 % pour le bac général. Des chiffres qui peuvent rassurer sur le papier, mais qui alimentent aussi les critiques sur une possible inflation des notes et une baisse de l’exigence.
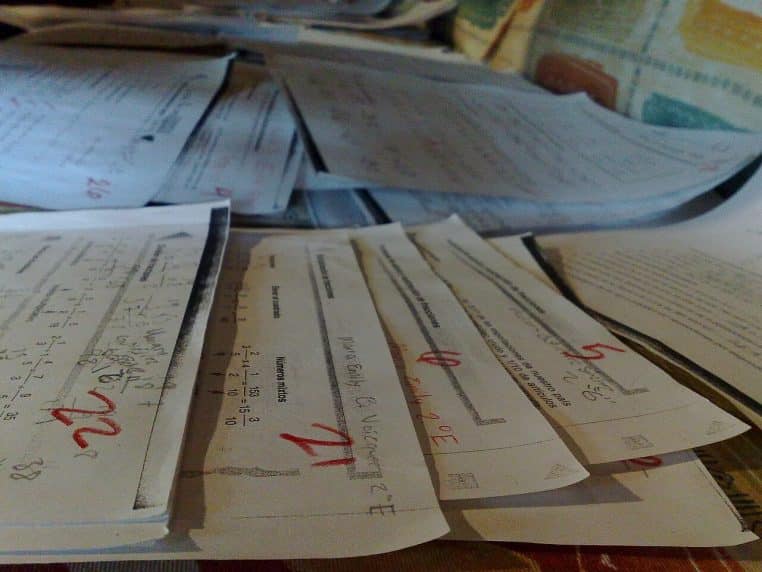
Crédit : Avecus / Wikimedia Commons (CC0)
Une cible jugée mauvaise par un spécialiste de l’école
Invité au micro de RTL, l’enseignant et essayiste Jean-Paul Brighelli n’a pas mâché ses mots. Il a ironisé sur cette nouvelle ligne dure, estimant que le ministre « se trompe de cible ». Dans sa lecture, le cœur du problème ne serait pas la sanction mais la transmission. Autrement dit, ce n’est pas en punissant davantage qu’on va améliorer le niveau, mais en changeant en profondeur la manière d’enseigner.
Pour ce spécialiste, l’enjeu central n’est pas d’alourdir la pénalité sur les fautes d’orthographe, mais de prendre le temps de réapprendre la langue. Il pointe une école qui, depuis des années, a changé de priorités sans toujours préserver les fondamentaux. Selon lui, la réforme annoncée arrive à l’autre bout de la chaîne : au lieu de travailler en amont sur le niveau, on durcit la sanction au moment où tout se joue pour les lycéens.
Ce discours bouscule l’idée, assez répandue, qu’un examen plus sévère suffirait à relever le niveau général. Brighelli rappelle, en creux, que la copie du bac est le reflet de tout ce qui s’est passé avant, du primaire à la Terminale. Si le socle est fragile, resserrer le barème de notation des copies ne ferait qu’officialiser l’échec sans le traiter.
À lire aussi
Les habitudes de lecture des jeunes dans le viseur
Pour expliquer la multiplication des erreurs et des maladresses dans les copies, l’enseignant met aussi en cause les pratiques culturelles des adolescents. Il évoque un contraste frappant : les jeunes liraient à peine une douzaine de minutes par jour, alors qu’ils passeraient près de quatre heures sur les réseaux sociaux.
Ce déséquilibre, selon lui, a des conséquences directes sur la maîtrise de la langue. Moins de romans, moins d’articles longs, moins de confrontation à des phrases structurées : la lecture des jeunes se réduit souvent à des flux de messages courts, de vidéos et de commentaires fragmentés. Difficile, dans ces conditions, de maîtriser la syntaxe ou de mémoriser l’orthographe de mots rarement croisés en dehors de la salle de classe.
Brighelli estime qu’« il faut tout reprendre », non seulement dans les programmes, mais aussi dans la manière d’accompagner les élèves vers la lecture. L’idée sous-jacente est simple : sans immersion régulière dans des textes exigeants, le niveau de langue ne peut que s’éroder. Durcir ensuite la correction du bac reviendrait à fermer la porte au dernier moment, sans avoir réellement aidé les candidats à franchir le seuil.

Crédit : Uxptr / Wikimedia Commons (CC0)
Un examen massifié… et de plus en plus critiqué
Le baccalauréat n’a pourtant pas toujours été associé à de tels taux de réussite. Dans les années 1960, seule une minorité de jeunes obtenait le diplôme : environ un sur dix passait ce cap. Ce chiffre illustre la transformation en profondeur de l’examen, passé d’un filtre très sélectif à un examen national massifié, presque incontournable pour poursuivre des études.
Aujourd’hui, plus de neuf candidats sur dix décrochent leur bac. Pour certains observateurs, cette massification est une victoire démocratique : davantage d’élèves poursuivent vers le supérieur, les parcours se diversifient, et la réussite scolaire ne serait plus réservée à une élite. Mais la contrepartie, souvent soulignée, est la crainte d’un affaiblissement de l’exigence et d’un diplôme qui ne distinguerait plus vraiment les niveaux.
C’est dans ce contexte que revient régulièrement l’idée d’une réforme du bac. Le durcissement de la notation apparaît alors comme une tentative de rééquilibrage, après plusieurs décennies de hausse continue de la réussite. Pourtant, la question posée par Brighelli demeure : la sévérité à l’examen suffit-elle à restaurer la confiance dans le diplôme, ou risque-t-on surtout de pénaliser une génération déjà fragilisée par ses conditions d’apprentissage ?
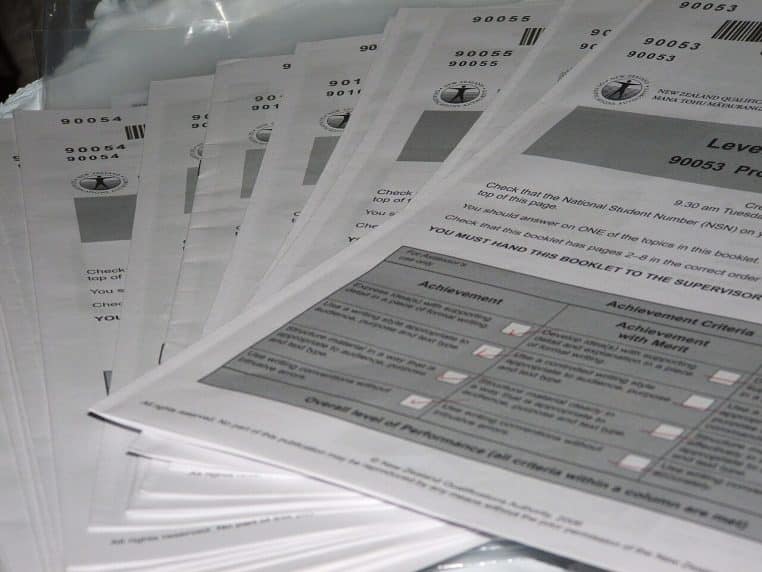
Crédit : Gabriel Pollard / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5)
Redoublement massif, salles saturées : le scénario qui inquiète
À partir de ce constat, une autre interrogation se dessine : que se passerait-il si l’on corrigeait les copies d’aujourd’hui avec l’exigence d’il y a quarante ans ? Autrement dit, si l’on appliquait un barème de notation comparable à celui d’une époque où le bac était beaucoup plus sélectif, combien d’élèves passeraient encore la barre ?
À lire aussi
Jean-Paul Brighelli avance une conséquence immédiate : un redoublement en Terminale beaucoup plus massif. Il évoque la perspective de classes remplies d’élèves contraints de repasser l’examen, faute d’avoir obtenu la moyenne avec ce nouveau regard plus sévère sur leurs copies. Le système, déjà soumis à de fortes tensions, pourrait-il absorber une telle vague de redoublants ?
L’enseignant souligne plusieurs limites très concrètes. Les lycées n’auraient pas la place d’accueillir une telle augmentation du nombre d’élèves en fin de cycle. Les équipes pédagogiques, déjà sollicitées, ne disposent pas non plus de marges pour prendre en charge des cohortes entières supplémentaires. Sans compter la réaction des familles : accepter qu’un enfant refasse son année de Terminale est une décision lourde, sur le plan psychologique comme sur le plan financier.

Crédit : Oregon Department of Transportation / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
Un bac entre symbolique sociale et réalité du niveau
L’histoire du baccalauréat est intimement liée à celle de l’école française. Longtemps perçu comme un rite de passage, il marque l’entrée dans les études supérieures et, d’une certaine façon, dans la vie adulte. Aujourd’hui encore, sa réussite reste célébrée comme un moment fort dans de nombreuses familles. Mais cette dimension symbolique peut se heurter à la perception d’un diplôme « donné » trop facilement.
Les chiffres récents, avec plus de 90 % de réussite, nourrissent ce débat. Certains y voient la preuve que les lycéens sont mieux accompagnés, d’autres y lisent une forme de « pilotage par les statistiques ». En toile de fond, une question revient : un diplôme presque universel peut-il garder la même valeur sociale qu’à l’époque où seuls quelques élus l’obtenaient ?
C’est là que la proposition implicite de Brighelli crée un léger vertige. Il rappelle que, dans les années 1960, à peine un jeune sur dix obtenait son bac. Puis il imagine ce que donnerait une correction actuelle calquée sur la rigueur d’il y a quarante ans. Selon lui, le taux de réussite du bac tomberait alors autour de 60 %, laissant près de 40 % des candidats sur le carreau et contraints de redoubler leur Terminale. Une hypothèse qui, à elle seule, mesure l’écart entre l’examen tel qu’il existe aujourd’hui et celui que certains regrettent peut-être un peu trop vite.






